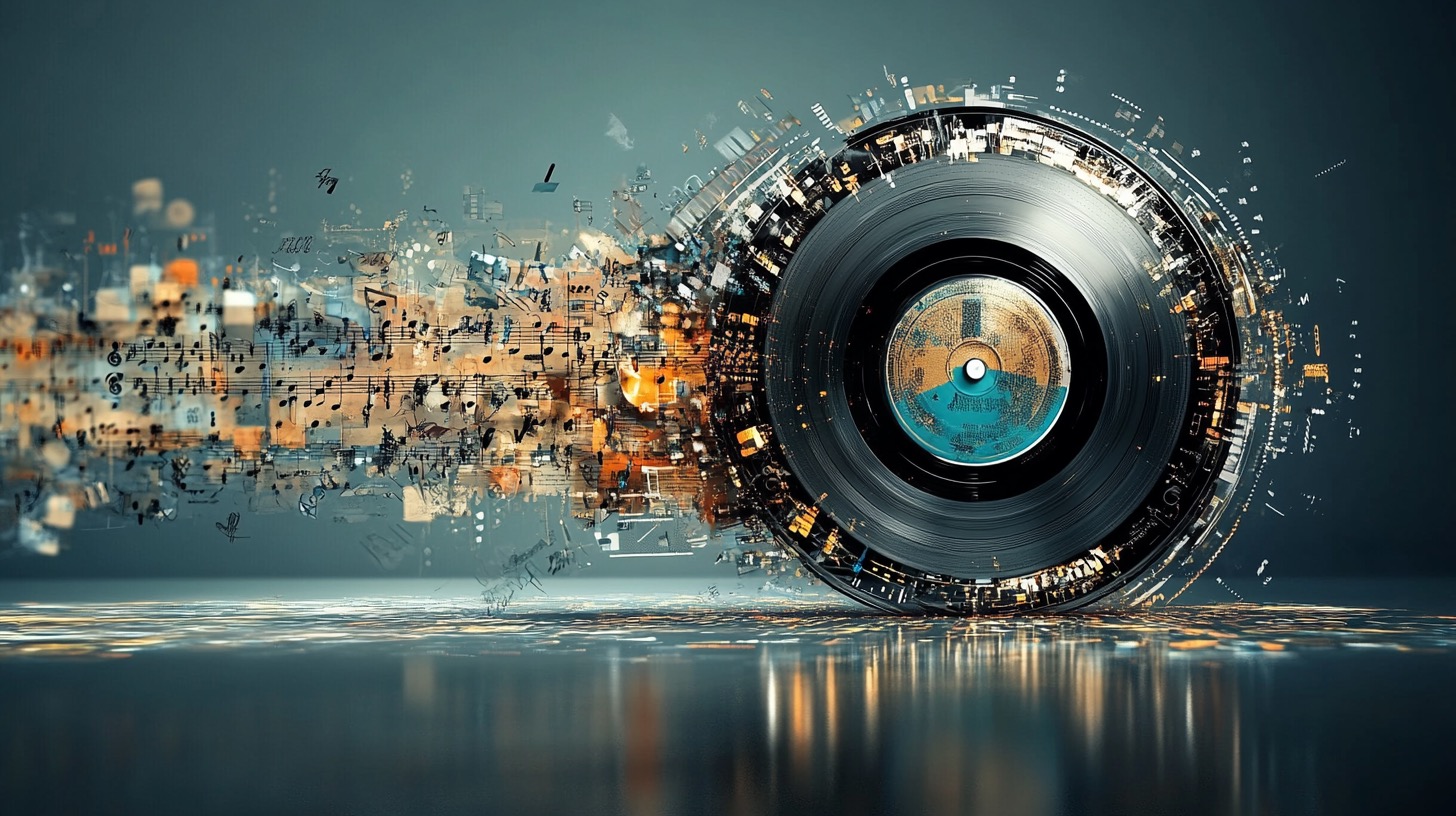Chaque semaine, des dizaines de nouveaux albums arrivent à la rédaction de Maxazine. Beaucoup trop pour tous les écouter, et encore moins pour les chroniquer. Une critique par jour signifie que trop d’albums restent dans l’ombre. Et c’est dommage. C’est pourquoi nous publions aujourd’hui un aperçu des albums qui arrivent à la rédaction sous forme de critiques courtes.
Bloodstain – I Am Death
Bloodstain est un jeune groupe prometteur originaire de Suède. Les membres du groupe ont 18/19 ans, et lors de l’enregistrement de ce mini-album de six titres, les garçons n’avaient que 17 ans. Je ne partage pas les superlatifs utilisés dans la biographie fournie. Par exemple, le batteur Benjamin Norgren est comparé à Dave Lombardo et le chanteur/guitariste Linus Lindin à Mark Osegueda de Death Angel. Ils en sont encore loin. Néanmoins, les jeunes maîtrisent bien leurs instruments et les compositions, influencées par le premier Metallica, sonnent déjà relativement matures. Le morceau d’ouverture et titre éponyme “I Am Death” est basé sur le film “Le Septième Sceau” du réalisateur suédois Ingmar Bergman, dans lequel le protagoniste joue une partie d’échecs avec “la Mort”. Pour l’excellent son, Bloodstain a bénéficié de l’aide de quelques noms connus. Le producteur Simon Johansson de Soilwork, le co-producteur Stefan Norgren, père du batteur Benjamin Norgren et membre des groupes Sorcerer et Seventh Wonder. L’album a été mixé et masterisé par Ronnie Björnström, qui a récemment travaillé avec Meshuggah. Le style musical peut être décrit comme du thrash old school de la Bay Area avec de nombreuses influences NWOBHM qui se manifestent particulièrement dans le travail des guitares. De nombreux et beaux solos de guitare (jumelés). Bloodstain n’a pas encore de contrat discographique, mais ce n’est qu’une question de temps une fois que les pontes de l’industrie auront écouté cet excellent premier album. Un groupe à surveiller ! (Ad Keepers) (7/10) (Valfrid Musik)
John Patitucci, Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall
Avec “Spirit Fall”, trois vétérans reprennent le fil qu’ils avaient laissé en 2000 avec “Imprint”. Le bassiste John Patitucci, le saxophoniste Chris Potter et le batteur Brian Blade forment un trio qui sonne comme des retrouvailles chaleureuses entre vieux amis. Leurs chemins se sont croisés auparavant auprès de grands noms comme Wayne Shorter et Chick Corea. Maintenant, sous la direction de Patitucci, ils présentent dix morceaux enracinés dans la tradition bebop mais qui swinguent comme une jam session contemporaine. Leur interprétation de “House of Jade” de Shorter fait un clin d’œil intelligent à leur histoire commune. Le format trio donne à chaque musicien l’espace pour exceller. Du dynamique “Think Fast” au titre intimiste “Spirit Fall” – la virtuosité est palpable. La production capture parfaitement la vivacité de leur interaction, tandis que la clarté du mixage permet de suivre chaque détail. “Spirit Fall” n’est pas un album révolutionnaire, mais une confirmation de leur maîtrise. C’est un album que les amateurs de jazz peuvent apprécier à sept sur dix – pas une sortie qui repousse les limites, mais une qui continue de fasciner. (Jan Vranken) (7/10) (Edition Records)
Horsegirl – Phonetics on and on
Et vous voilà, quelque part entre les salles de répétition poussiéreuses de Chicago et les studios étincelants où Cate Le Bon est aux commandes, avec le deuxième album de Horsegirl. “Phonetics On and On” est comme un road trip où l’on n’est pas tout à fait sûr d’avoir pris la bonne sortie. Alors que leurs débuts débordaient d’énergie juvénile, le trio opte maintenant pour un paysage plus dépouillé. La production de Le Bon réduit tout à l’os, un choix audacieux qui fonctionne parfois (“2468”, “Where’d You Go”) mais sombre plus souvent dans la monotonie (“Sport Meets Sound”, “In Twos”). L’écriture reste au stade d’esquisse – des refrains simples “la di la la” et une poésie de carnet qui promet plus qu’elle ne livre. C’est comme un film indé tellement désireux d’être de l’art qu’il en oublie de raconter une histoire. Pourtant, cet album mérite le respect pour son ambition. Horsegirl tente ici ce que peu de groupes osent sur leur deuxième album : recommencer complètement. Le résultat est un album qui fascine et frustre, qui expérimente avec le silence mais oublie parfois de remplir ce silence de sens. Un document courageux mais inachevé d’un groupe en transition. (Jan Vranken) (6/10) (Matador)
Kelela – In the Blue light
Dans les murs patinés du Blue Note, où jadis John Coltrane faisait chanter son saxophone, Kelela a écrit un nouveau chapitre. “In The Blue Light” ressemble à une balade nocturne à travers Manhattan, où le jazz et la R&B se rencontrent dans la pénombre. Sur douze morceaux, Kelela nous emmène dans un voyage intime, sa voix – telle une Cadillac vintage sur des pneus de velours – glissant avec fluidité à travers les arrangements. La production est cristalline, comme si vous étiez au premier rang de ce club de jazz légendaire, tandis que le groupe, tel une machine bien huilée, élève chaque morceau vers de nouveaux sommets. Le point culminant absolu est son interprétation de “Furry Sings The Blues” de Joni Mitchell. Là où l’original de Mitchell dépeignait la mélancolie de Memphis, Kelela transforme le morceau en une expérience quasi spirituelle, sa voix vous enveloppant comme une chaude nuit de La Nouvelle-Orléans. Pourtant, ce n’est pas le meilleur album de 2025. Malgré l’exécution impeccable et les moments magiques – particulièrement dans des morceaux comme “Better” et “Bank Head” – il manque parfois ce sentiment de transformation totale qui caractérise les plus grands albums live. Mais avec un solide 8, Kelela prouve qu’elle a sa place dans le panthéon des artistes qui ont fait du Blue Note un lieu sacré. (Jan Vranken) (8/10) (Blue Note)
Richard Dawson – End of the Middle
Quelque part dans un recoin de la scène folk britannique, où les bords rugueux de la tradition sont encore palpables, Richard Dawson a tracé son propre chemin pendant des années. Tel un mineur obstiné qui refuse de poser ses outils, même lorsque la mine est depuis longtemps abandonnée. Avec “End of the Middle”, il semble cependant s’être égaré dans son propre labyrinthe artistique. Les neuf morceaux de cet album sonnent comme des enregistrements de terrain d’une réalité alternative où la valeur de production n’aurait jamais été inventée. Le morceau d’ouverture “Bolt” est une épreuve qui rappelle les premiers enregistrements bruts de Jandek – mais sans l’aliénation fascinante qui rend le travail de Jandek si intrigant. Les exercices vocaux de Dawson sont comme une conversation entre une girouette rouillée et un diapason désaccordé. Alors que son travail précédent, comme l’ambitieux “Peasant” de 2017, avait encore un certain charme brut, ici, toute tentative de cohérence mélodique semble avoir été abandonnée. Le désaccord de sa guitare n’est plus un choix artistique, mais une métaphore de l’album entier. La structure textuelle vacille comme un château de cartes dans une tempête. Là où le folk traditionnel vit par la grâce de sa précision métrique, comme nous le connaissons des maîtres comme Martin Carthy, Dawson semble ici improviser au bord du chaos. C’est comme s’il avait lu le manuel d’écriture de chansons, mais avait décidé de l’appliquer à l’envers. C’est du DIY dans sa forme la plus extrême, mais sans l’urgence qui peut justifier de telles productions brutes. Là où un artiste comme Will Oldham utilise son esthétique lo-fi pour créer de l’intimité, Dawson construit ici involontairement des murs d’inaccessibilité. Pour l’auditeur curieux, il y a peut-être quelque chose à tirer de cette lutte sonique, comme une étude anthropologique des limites du folk anti-commercial. Pour tous les autres, cet album est comme une longue promenade sous la pluie sans manteau – une expérience que l’on préfère éviter. (Jan Vranken) (1/10) (Domino Recording)