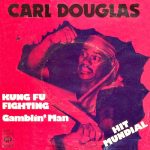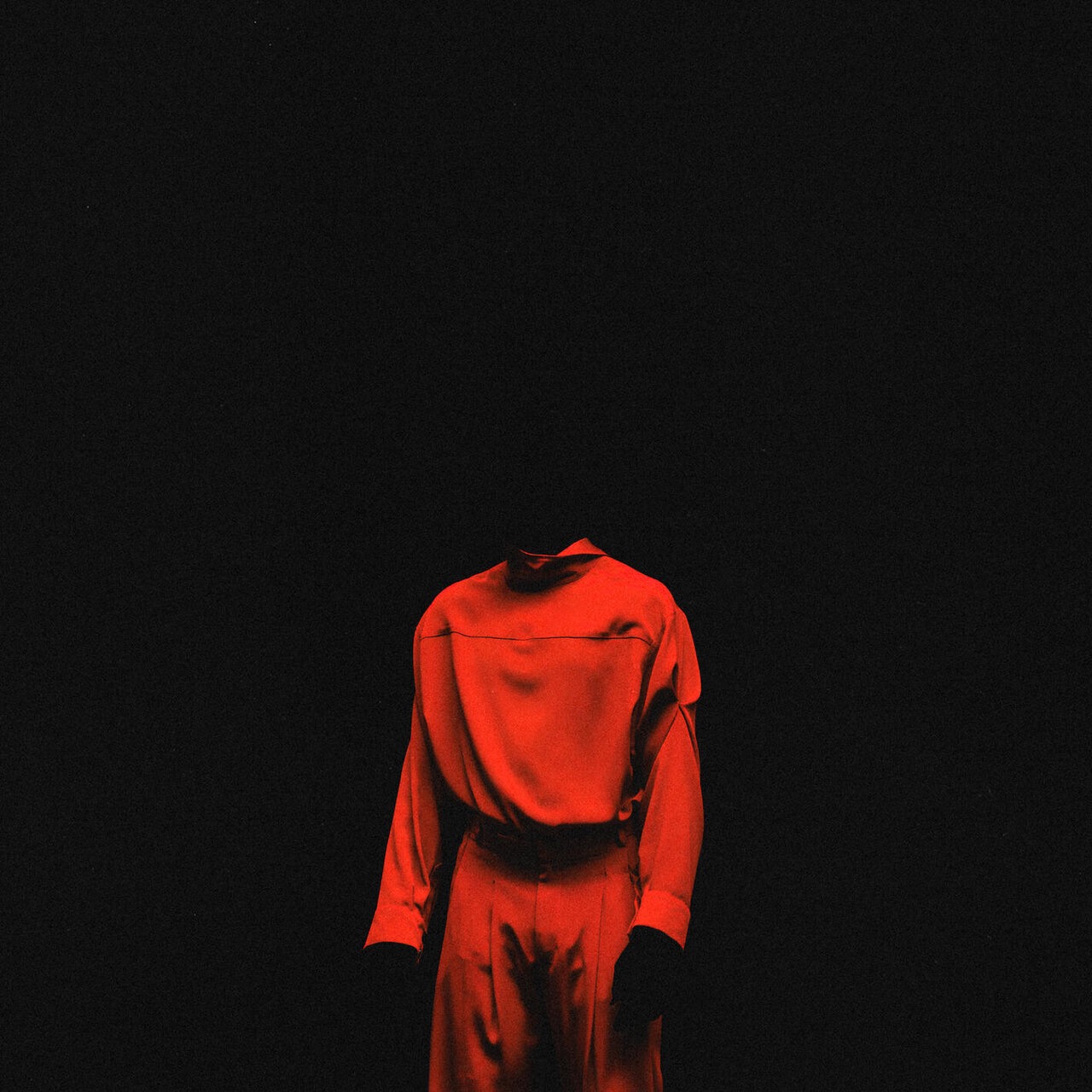C’est un paradoxe étonnant : plus une pianiste joue Mozart avec perfection, plus elle s’éloigne parfois de l’essence même de sa musique. Le nouvel album d’Angela Hewitt, qui parachève sa trilogie Mozart, illustre ce dilemme de façon saisissante. On y trouve une perfection technique si léchée qu’elle en devient presque stérile – exactement ce que l’élégance naturelle de Mozart ne supporte pas.
Soyons francs : encore une interprétation de Mozart en 2025 fait l’effet du énième livre sur l’art de respirer. Avec le 270e anniversaire de Mozart qui approche, nous pouvons nous préparer à un déluge d’éditions commémoratives, chacune prétendant apporter quelque chose de « nouveau » à un répertoire si exhaustivement labouré que chaque centimètre carré a déjà été exploré, analysé et réinterprété. L’œuvre mozartienne est désormais si rabâchée qu’elle risque de perdre sa spontanéité sous le poids de toutes ces exécutions parfaites.
Hewitt est certes reconnue pour son articulation cristalline et sa technique irréprochable – qualités qui ont fait de son cycle Bach une référence. Mais là où la complexité architecturale de Bach profite d’une telle précision, l’éloquence naturelle de Mozart semble s’en trouver étouffée. Ces sonates – du dramatique K457 en ut mineur aux défis contrapuntiques du K576 – exigent une certaine désinvolture, un sentiment de perfection improvisée qui fait défaut ici à Hewitt.
Le problème ne réside pas dans ce que fait Hewitt, mais dans ce qu’elle omet. Chaque note est à sa place, chaque phrase soigneusement modelée, chaque transition dynamique exécutée avec métier. Son piano Fazioli sonne de façon lumineuse, la qualité d’enregistrement est exemplaire. Mais où reste l’effet de surprise ? Où sont ces moments où l’on se dit soudain : « Ah, c’est donc cela que voulait dire Mozart » ?
Dans K545, la fameuse « Sonata facile », Hewitt démontre une maîtrise parfaite de ce que Schnabel décrivait jadis comme « trop facile pour les enfants, trop difficile pour les adultes ». Son doigté est admirable, son interprétation de la simplicité apparente, intelligente. Pourtant, on regrette cette légèreté espiègle que savent trouver les grands mozartiens comme Uchida ou Perahia – cette sensation que Mozart lui-même est assis au clavier en train d’improviser.
K457 en ut mineur offre à Hewitt davantage de possibilités dramatiques, et c’est là qu’elle approche le plus de la percée émotionnelle. Son approche des octaves d’ouverture est impressionnante, les passages polyphoniques du dernier mouvement reçoivent la clarté qu’on peut attendre d’une spécialiste de Bach. Mais même ici, chaque élan semble soigneusement planifié, chaque explosion disciplinée.
Il serait peut-être injuste de reprocher à Hewitt de faire ce en quoi elle excelle. Sa perfection technique n’est pas un défaut – c’est un don qu’elle emploie avec constance. Le problème est plus profond : dans un répertoire si inondé d’excellentes exécutions, l’excellence seule ne suffit plus. Nous avons besoin d’interprétations qui ajoutent quelque chose d’essentiel, qui nous font redécouvrir pourquoi cette musique importe.
Les sonates tardives de Mozart contiennent des moments de profonde mélancolie (surtout dans K570), des éclairs d’humour, et une inventivité architecturale qui annonce Beethoven. Hewitt enregistre tout cela avec exactitude, mais ne le transforme pas. Elle nous donne Mozart au microscope : chaque détail parfaitement visible, mais la magie de l’ensemble quelque peu perdue.
Ce n’est pas un mauvais album – loin de là. Pour les mélomanes qui apprécient les interprétations claires et réfléchies sans excès, Hewitt offre exactement ce qu’ils cherchent. Ses notes de pochette témoignent d’une connaissance approfondie, son métier pianistique est incontestable. Mais dans un marché saturé d’enregistrements mozartiens, cet album aurait pu bénéficier de cette étincelle supplémentaire qui distingue les interprétations des reproductions.
Mozart mérite mieux que la perfection – il mérite la vie.
Hyperion Records | (7/10)