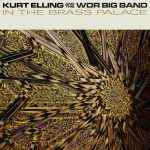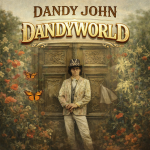Dans un hôtel paisible, loin de l’agitation de l’industrie musicale, Alan Parsons partage des crevettes grillées avec son épouse. Un mardi après-midi ordinaire ; pas de chichis, pas de comportement de rock star, simplement un homme savourant un moment de tranquillité. « Asseyez-vous, prenez des crevettes », dit-il avec le sourire. Cette hospitalité spontanée donne immédiatement le ton. Il ne s’agira pas d’une interview classique sur les tubes et les succès. Ce sera une conversation sur l’artisanat.
Parsons, l’homme derrière le son de “The Dark Side of the Moon” et “Abbey Road”, a été témoin de l’histoire de la musique de très près. Mais il ne romantise pas cette époque. « Les ingénieurs d’Abbey Road étaient toujours plus contents quand on respectait les horaires fixes », se souvient-il. « De dix heures à une heure, puis pause déjeuner, ensuite de deux à cinq, puis pause dîner. » Mais la réalité était autre. « On comprend bien que les artistes ne peuvent pas toujours créer selon un emploi du temps précis. Les ingénieurs et producteurs suivaient alors le mouvement. On disait simplement : on est bien lancés, pourquoi s’arrêter juste parce que c’est l’heure de la pause ? »
Cette approche, la qualité avant l’horloge, caractérisait sa génération. Les albums étaient forgés, non assemblés. « J’ai toujours enregistré avec un flux dans la musique », explique Parsons. « On perd cela quand les morceaux sont écoutés séparément sur Spotify et enregistrés isolément. » Sa curiosité pour la technologie reste intacte. Sur “The Secret”, il a expérimenté avec la fréquence de Schumann, 7,83 hertz, supposée être la fréquence de résonance de l’univers. « Nous avons de bons contacts à la NASA et à l’ESO », dit-il avec enthousiasme. « C’est très difficile à reproduire. On ne peut pas simplement l’enregistrer. » Ce défi technique correspond à sa philosophie. Il cite Arthur C. Clarke : « Une technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » Pour Parsons, ce n’est pas une formule vide, mais une méthode de travail qui perdure depuis cinq décennies.
Mais son ton s’assombrit ensuite. L’état actuel de l’industrie musicale le frustre profondément. « Le problème, c’est que les consommateurs s’attendent à ce que la musique soit gratuite, ou presque. Chaque lecture en streaming rapporte à l’artiste 0,00001 centime. » Ces chiffres ne mentent pas. « Un artiste établi vendait autrefois un million d’exemplaires ; aujourd’hui, je suis déjà heureux si je vends 50 000 exemplaires d’un album dans le monde. » Il évoque Peter Frampton, qui a gagné environ sept dollars grâce à des millions d’écoutes sur Spotify. « Magnifique, non ? », dit-il en souriant.
Cette réalité économique touche au cœur de sa frustration. « Ça ne peut pas continuer comme ça. Tant que la musique coûte de l’argent et que les artistes doivent survivre, personne n’enregistrera de musique sans être rémunéré. » Ce qui dérange le plus Parsons, c’est la culture des playlists. « C’est déprimant d’être considéré comme une simple entrée dans une playlist. Un morceau à toi, puis un autre d’un inconnu, puis un autre encore. »
Ce sentiment va bien au-delà de la nostalgie. L’album, en tant que forme artistique musicale, ce voyage soigneusement construit d’une piste à l’autre, est en danger. Pour un artisan comme Parsons, qui passe des mois à peaufiner l’équilibre parfait entre les morceaux, cela relève du vandalisme artistique. « J’ai toujours enregistré de manière à ce qu’il y ait un flux dans la musique », insiste-t-il à nouveau. Ce flux, cette construction minutieuse, la manière dont un morceau introduit le suivant, tout cela exige du temps, de la patience, et oui, de l’argent.
Sa passion pour la perfection se manifeste dans des recoins inattendus. Parsons collectionne les tours de magie et possède « une immense collection de tours et de livres à la maison, dont beaucoup restent non lus ». Interrogé sur ses talents, il sourit : « J’y travaille. Une pièce d’un euro, tu peux en faire deux ? Oui, mais pas maintenant. » Cette précision, ce dévouement à l’art, même en tant que loisir, résume toute son approche. Faire de la musique, c’est bien plus que rassembler des chansons. C’est un artisanat qui exige du temps et du respect.
Après près de vingt ans passés en Amérique, l’Anglais Parsons a trouvé son rythme. Travaillant depuis son propre studio, il s’entoure de collaborateurs de confiance. « C’est presque une affaire de famille maintenant », dit-il. Cette approche familiale correspond à sa philosophie. La qualité ne naît ni dans la hâte ni sous la pression, mais dans la confiance, le temps et l’espace pour expérimenter. Les avocats dans son jardin servent de métaphore : « On regarde simplement comment ça pousse. »
Malgré toutes les frustrations, Parsons reste optimiste. Le retour du vinyle lui redonne espoir. « Si le vinyle continue d’attirer l’attention, les gens pourraient se dire : j’aime tenir un objet tangible entre mes mains. Je mets un album, et je l’écoute en entier. » Il reconnaît aussi ses échecs, comme une tentative ratée dans la musique électronique de danse (le dernier album de The Alan Parsons Project, “The Sicilian Defense”), mais sans aucun regret. « Je suis content de l’avoir fait, content d’avoir reconnu ma grande passion dans la vie. »
Alors que notre conversation est interrompue par des appels à propos de la logistique de sa tournée, le message central de Parsons devient clair. À l’ère des algorithmes et de la culture de la playlist, il continue de s’accrocher à un principe simple : la qualité exige du temps, du dévouement et du respect pour l’artisanat. « Je n’ai rien à ajouter », dit-il, pensif. C’est la sérénité de quelqu’un qui a connu plusieurs révolutions musicales, et qui en est ressorti avec son intégrité intacte.
Le secret, non seulement le titre de son album mais aussi sa devise de vie, est peut-être celui-ci : la vraie qualité ne naît pas dans la précipitation. Elle grandit, comme les avocats dans son jardin, quand on prend le temps de bien faire les choses.
Foto (c) Marcel Hakvoort