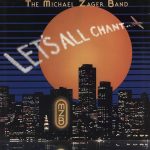The People Who Can’t Handle Jazz: What a Hollywood Movie Taught Me About Ambiguity, Improvisation, and Why Some Minds Need All the Answers A longread about the psychological trait that separates those who embrace uncertainty from those who fear it.
Mon ami Perry et moi sortions du théâtre après avoir vu “One Battle After Another”, et il secouait déjà la tête. ‘Ce n’était pas assez réaliste,’ se plaignait-il. Les scènes d’action étaient trop chorégraphiées. Les dialogues trop vifs. La résolution trop nette. Je l’ai regardé. ‘Perry,’ lui dis-je prudemment, ‘c’est un film hollywoodien. À quoi t’attendais-tu exactement, un documentaire ?’
Il haussa les épaules, insensible à l’ironie. Il avait acheté un billet pour un film à gros budget de Paul Thomas Anderson et avait ensuite passé 161 minutes à le dénigrer mentalement parce qu’il n’était pas un portrait sur le vif d’un combat réel. C’était comme commander une pizza et se plaindre que ce n’était pas une salade. Pourtant, cette conversation m’est restée, car j’avais déjà vu ce schéma. Non pas dans les salles de cinéma, mais dans les clubs de jazz. Au fil des ans, j’ai vu d’innombrables personnes—des gens intelligents, cultivés—confesser avec une anxiété sincère dans la voix : ‘Je ne peux juste pas écouter de jazz. Ça me rend nerveux.’ Au début, je pensais qu’ils parlaient du bagage historique, de l’élitisme culturel, du côté intimidant et branché de tout cela. Mais plus je leur parlais, plus c’était clair. Ce qui les rendait anxieux, ce n’était pas la culture du jazz. C’était le jazz lui-même. Son imprévisibilité. La façon dont il refusait de se résoudre comme ils s’y attendaient. Les espaces entre les notes où tout pouvait arriver. Ils étaient comme Perry dans cette salle de cinéma, incapables d’accepter le médium selon ses propres termes. Et je me suis mis à me demander : Et si ce qui pousse Perry à exiger que ses films hollywoodiens soient des documentaires est la même chose qui fait transpirer certaines personnes lorsque John Coltrane commence à improviser ? Et s’il existait un trait fondamental—une façon de traiter le monde—qui détermine si vous pouvez gérer l’incertitude, ou si vous avez besoin que tout se résolve en réponses claires et prévisibles ? Il s’avère que oui. Et cela explique beaucoup plus que de simples préférences musicales.
La science de ne pas savoir
Le trait est appelé la tolérance à l’ambiguïté, et il est étudié discrètement par les psychologues depuis des décennies. En termes simples, il mesure votre niveau de confort face à des situations qui n’ont pas de réponses claires, de significations stables ou de résultats prévisibles.
Le trait est appelé la tolérance à l’ambiguïté, et il est étudié discrètement par les psychologues depuis des décennies. En termes simples, il mesure votre niveau de confort face à des situations qui n’ont pas de réponses claires, de significations stables ou de résultats prévisibles. Les personnes ayant une tolérance élevée à l’ambiguïté, selon une recherche publiée dans Frontiers in Psychology, trouvent en fait les situations incertaines souhaitables—pleines de possibilités plutôt que de menaces. Les personnes ayant une faible tolérance éprouvent exactement le contraire : les situations ambiguës génèrent de l’anxiété car elles manquent des informations nécessaires à la clôture cognitive, déclenchant des réponses de stress alors que le cerveau essaie désespérément de résoudre l’incertitude.
Pensez-y comme à deux systèmes d’exploitation différents. L’un prospère avec les questions ouvertes. L’autre plante lorsqu’il ne peut pas calculer une réponse définitive. La construction comporte quatre dimensions principales, ont découvert les chercheurs : un désir de prévisibilité, une tendance à être paralysé face à l’incertitude, une tendance à éprouver de la détresse face à l’incertitude, et des croyances inflexibles concernant l’incertitude elle-même. Il ne s’agit pas seulement d’être anxieux ou névrosé. C’est plus profond que cela. Il s’agit de savoir si votre cerveau considère l’inconnu comme un ennemi ou une invitation. Et c’est là que ça devient intéressant : la tolérance à l’ambiguïté est fortement corrélée à un trait de personnalité appelé l’ouverture à l’expérience—l’une des dimensions de la personnalité du ‘Big Five’ que les psychologues utilisent pour cartographier le tempérament humain. Des études ont constamment révélé que les personnes très ouvertes à l’expérience préfèrent la musique catégorisée comme complexe et nouvelle, comme le classique, le jazz et les styles éclectiques, tout en privilégiant les genres intenses et rebelles. Ce n’est pas seulement que les personnes ouvertes aiment le jazz. C’est que leur cerveau est câblé pour trouver de la beauté dans la chose même qui rend les autres anxieux : l’absence de certitude.
Quand le jazz est devenu l’ennemi
Pour comprendre pourquoi le jazz est devenu le test ultime de la tolérance à l’ambiguïté, il faut remonter aux années 1940, lorsque la musique a commis ce qui pourrait être le plus grand acte de rébellion artistique de l’histoire américaine : elle a refusé de vous laisser danser. Avant le bebop, le jazz était fondamentalement une musique sociale. Les orchestres de swing remplissaient les salles de bal. Les gens bougeaient dessus, tapaient des mains, flirtaient dessus. La musique avait un travail : faire danser les gens et les y maintenir. Cela signifiait des rythmes réguliers, des structures prévisibles et des mélodies que l’on pouvait fredonner en rentrant chez soi. Puis sont arrivés Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, et une génération de jeunes musiciens qui ont regardé ces pistes de danse bondées et ont dit : et si nous faisions de la musique qui exige que vous vous asseyiez et que vous écoutiez ?
Pour les critiques hostiles, le bebop semblait rempli de ‘phrases nerveuses et rapides’. Les tempos étaient plus rapides que ce que quiconque pouvait danser. Les changements d’accords venaient si vite qu’ils semblaient être une ruse. L’ensemble semblait conçu pour intimider, exclure, annoncer que le jazz n’était plus du divertissement—c’était de l’art, et vous feriez mieux d’y prêter attention. La nouvelle musique n’était plus principalement une musique de danse, et elle ne se définissait plus comme un divertissement commercial. C’était de la musique pour les musiciens, par les musiciens, sur l’acte pur de la création lui-même. La réponse fut prévisible. Le bebop était inacceptable non seulement pour le grand public, mais aussi pour de nombreux musiciens lorsqu’il a émergé, y compris Louis Armstrong, qui a condamné la nouvelle musique comme étant bruyante et ‘sans swing’.
Louis Armstrong
l’homme qui avait essentiellement inventé le jazz comme une forme d’art pour soliste—pensait que le bebop était allé trop loin. Si Satchmo ne pouvait pas le supporter, quel espoir restait-il à l’auditeur moyen ? But here’s the thing about bebop: it wasn’t trying to alienate people. It was trying to expand what music could do. Bebop marked the stage at which jazz completed its transformation from entertainment into art. For the first time, the musicians and their audience became widely conscious that jazz was an art form requiring serious listening. En d’autres termes, le bebop demandait à son public de faire quelque chose que les personnes avec une faible tolérance à l’ambiguïté trouvent presque impossible : abandonner le contrôle. Arrêter d’attendre une résolution. Faire confiance à l’improvisateur pour vous emmener quelque part où vous n’êtes jamais allé, sans promettre que vous aimerez l’endroit où vous arriverez. Pour certains auditeurs, c’était la libération. Pour d’autres, c’était de la torture.
L’équation moderne
Avançons rapidement vers les années 1980 et 90, et l’on pourrait penser que le jazz se serait adouci, serait devenu plus accessible. D’une certaine manière, il l’a fait—l’essor du “smooth jazz” a rendu le genre sûr pour les cabinets de dentiste partout. Mais les joueurs sérieux ont continué à pousser. Prenons les Yellowjackets, un groupe de fusion lauréat d’un Grammy qui explore l’intersection du jazz, du funk et de la pure complexité musicale depuis plus de quatre décennies. Leur capacité unique à mélanger une théorie musicale complexe avec une improvisation spontanée rend chaque performance distincte, un événement en soi. Leur son a toujours été une combinaison d’optimisme et de complexité, avec des compositions comportant des signatures rythmiques délicates, des enchaînements ondulants et des explosions d’énergie ensoleillées. Ce qui rend les Yellowjackets fascinants, c’est qu’ils rendent la complexité invitante. Leur musique est exigeante—changements de signatures rythmiques, structures harmoniques denses, interaction complexe entre les instruments—mais elle ne ressemble jamais à un devoir. Il y a de la joie, le sentiment que toute cette complexité sert un but émotionnel plutôt que de simplement faire étalage.
Ce qui rend les Yellowjackets fascinants, c’est qu’ils rendent la complexité invitante. Leur musique est exigeante—changements de signatures rythmiques, structures harmoniques denses, interaction complexe entre les instruments—mais elle ne ressemble jamais à un devoir. Il y a de la joie en elle, le sentiment que toute cette complexité sert un but émotionnel plutôt que de simplement faire étalage. Mais même avec cette chaleur, même avec les grooves et l’accessibilité, certains auditeurs les trouvent toujours épuisants. Trop de choses se passent. Trop de choses changent en même temps. Où est le couplet ? Où est le refrain ? Quand est-ce que cette foutue chose se résout ? La réponse, bien sûr, est : ça se résout quand ça se résout. Ou peut-être que ça ne se résout pas du tout. Peut-être que ça se transforme, tout simplement. Et si cette réponse vous rend anxieux, eh bien—c’est un peu le but.
Itamar Borochov
L’homme qui vit dans deux incertitudes Si vous voulez voir la tolérance à l’ambiguïté dans sa forme la plus pure, regardez le trompettiste israélien Itamar Borochov jouer de sa trompette à quatre pistons et à quarts de ton, fabriquée sur mesure. Borochov crée un hybride entre les sons du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de son enfance à Jaffa et le jazz classique illustré par Louis Armstrong, Miles Davis, et John Coltrane. Mais ce n’est pas seulement une fusion de deux styles—c’est une fusion de deux logiques musicales complètement différentes. Le jazz occidental est construit sur le système de tempérament égal à douze tons. La musique du Moyen-Orient utilise les maqamat—des systèmes modaux qui incluent des quarts de ton, ces notes qui tombent entre les touches du piano. Borochov plays a custom-made Monette four-valve quarter-tone trumpet which he uses to incorporate maqams, the Middle Eastern microtonal modes that are the musical language of his traditional upbringing. Pensez à ce que cela signifie. Il improvise dans un espace musical où l’oreille occidentale ne peut littéralement pas prédire la note suivante. Même si vous êtes un musicien de jazz formé, même si vous connaissez tous les changements d’accords, Borochov peut jouer des notes qui n’existent pas dans votre catalogue mental. Il opère dans les interstices. Et il le fait intentionnellement. As he put it: ‘If Coltrane was informed by his father being a preacher, I had to do the same thing. Lee Morgan’s from Philly and I’m from Jaffa. He brought gospel and I’m bringing Sephardi synagogue music’. Ce que Borochov comprend—ce que tout grand musicien de jazz comprend—c’est que l’ambiguïté n’est pas un défaut. C’est la caractéristique. L’incertitude est l’endroit où vit la musique.
La vague israélienne
une culture d’incertitude confortable ? Borochov n’est pas une exception. Il fait partie de quelque chose de plus grand : une vague de musiciens de jazz israéliens qui sont devenus centraux sur la scène new-yorkaise au cours des trois dernières décennies.
Borochov n’est pas une exception. Il fait partie de quelque chose de plus grand : une vague de musiciens de jazz israéliens qui sont devenus centraux sur la scène new-yorkaise au cours des trois dernières décennies. Au moins une douzaine de joueurs israéliens ont atteint un niveau de reconnaissance enviable, notamment le bassiste Omer Avital et les frères et sœurs Cohen : le saxophoniste Yuval, la clarinettiste Anat et le trompettiste Avishai. Avital forma rapidement un sextet qui combinait le jazz traditionnel avec des rythmes et des mélodies du Moyen-Orient, reconnu aujourd’hui comme l’un des groupes les plus importants à avoir émergé sur la scène jazz de New York au milieu des années 1990. Another towering figure in this movement is bassist Avishai Cohen, a different artist from the trumpeter of the same name. Like Borochov, Cohen opère avec maestria dans les doubles mondes des traditions musicales occidentale et moyen-orientale. But Cohen takes this ambiguity even further, bringing it into the heart of European classical institutions. He has introduced this hybrid musical language to major European orchestras including the Metropole Orkest and the Antwerp Symphony Orchestra, creating entirely new musical worlds where jazz improvisation, Middle Eastern modes, and symphonic traditions converge. In these collaborations, the ambiguity multiplies: East meets West, improvisation meets orchestration, ancient meets contemporary. Cohen doesn’t resolve these tensions, he amplifies them, demonstrating that the space between worlds can itself become a destination. Ce qui est remarquable, ce n’est pas seulement le talent—c’est l’approche. Ces musiciens sont à l’aise d’exister dans de multiples identités simultanément. Israéliens et Américains. Moyen-Orientaux et Occidentaux. Traditionnels et avant-gardistes. Ils ne résolvent pas ces tensions ; ils les exécutent. Dans un sens, ils font ce qu’Israël fait lui-même : vivre dans une ambiguïté permanente. Le pays existe dans un état d’incertitude perpétuelle—géographiquement, politiquement, existentiellement. C’est peut-être pour cela que ses musiciens sont si doués pour faire de l’art à partir de l’irrésolution. Ou peut-être que j’interprète trop. Peut-être que c’est juste que le système d’éducation du jazz en Israël, en particulier dans des écoles comme la Thelma Yellin High School of the Arts, met l’accent sur l’improvisation et la voix individuelle plutôt que sur la perfection technique. Quoi qu’il en soit, la scène jazz israélienne représente quelque chose d’important : toute une génération de musiciens qui ont fait carrière en refusant de choisir entre leurs diverses influences. Ils vivent dans l’ambiguïté et la font chanter.
Giant Steps
Quand même Coltrane avait besoin d’une carte Mais revenons à la peur. Car si vous voulez comprendre pourquoi certaines personnes trouvent le jazz réellement anxiogène, il n’y a pas de meilleur exemple que John Coltrane’s “Giant Steps”.
Vox a décrit la pièce comme ‘la chanson la plus redoutée du jazz’ en raison de sa vitesse et de sa transition rapide à travers trois tonalités : Si majeur, Sol majeur et Mi bémol majeur. Il y a 26 changements d’accords dans le thème de 16 mesures, ce qui représente un formidable défi pour l’improvisateur avec ses centres de tonalité qui changent rapidement. Pour mettre cela en perspective : la plupart des chansons pop n’ont peut-être que quatre ou cinq accords au total. “Giant Steps” a 26 changements d’accords en 16 mesures, se déplaçant à travers trois centres de tonalité différents, à un tempo si rapide que vous avez à peine le temps d’entendre un accord avant qu’il ne passe au suivant. Lorsque Tommy Flanagan, le pianiste de l’enregistrement original, s’est assis pour l’enregistrer, il n’avait jamais vu la partition auparavant. Coltrane, à sa manière habituelle, l’a juste apportée au studio et a dit : faisons ça. Le solo de Flanagan sur la prise principale est célèbre parmi les musiciens de jazz—non pas parce qu’il est brillant, mais parce qu’il est honnête. Vous pouvez l’entendre se débattre, chercher des notes, essayer de suivre ces changements impossibles. Même Coltrane lui-même, le compositeur, s’est appuyé sur des motifs. L’analyse révèle que Coltrane a élaboré des motifs mélodiques sur les changements à l’avance et les a déployés pendant son improvisation enregistrée, utilisant certains motifs sous forme fondamentale quelque 35 fois. Pensez à cela. Le gars qui a écrit la progression d’accords la plus complexe de l’histoire du jazz avait encore besoin de petites roues pour naviguer. So what does ‘Giant Steps’ demand of the listener? It asks you to surrender any hope of following along intellectually. You cannot, in real time, track those chord changes unless you’ve spent years studying music theory. You can’t anticipate where it’s going. You can’t hum along. Tout ce que vous pouvez faire, c’est faire confiance. Faire confiance aux musiciens qu’ils savent où ils vont, même si vous ne le savez pas. Faire confiance au fait que le chaos est intentionnel. Faire confiance au fait que la résolution, si elle vient, sera selon les termes de la musique, pas les vôtres. Pour les personnes avec une tolérance élevée à l’ambiguïté, c’est passionnant. Pour les personnes avec une faible tolérance ? C’est comme être piégé dans une crise de panique musicale.
La neuroscience du lâcher-prise
Que se passe-t-il réellement dans le cerveau lorsque quelqu’un improvise ? Et que se passe-t-il dans le cerveau de l’auditeur ? Des chercheurs de Johns Hopkins ont placé des pianistes de jazz dans une machine IRMf et leur ont demandé d’improviser. Ce qu’ils ont découvert était fascinant : l’improvisation était constamment caractérisée par une désactivation étendue du cortex préfrontal dorsolatéral (la zone responsable de l’autosurveillance et du contrôle conscient) avec une activation focale du cortex préfrontal médial.
Des chercheurs de Johns Hopkins ont placé des pianistes de jazz dans une machine IRMf et leur ont demandé d’improviser. Ce qu’ils ont découvert était fascinant : l’improvisation était constamment caractérisée par une désactivation étendue du cortex préfrontal dorsolatéral (la zone responsable de l’autosurveillance et du contrôle conscient) avec une activation focale du cortex préfrontal médial. En langage simple : la partie de votre cerveau qui juge et contrôle s’arrête, tandis que la partie qui génère la pensée autoréférentielle s’allume. Les musiciens sont littéralement entrés dans un état où ils ont arrêté de se surveiller et ont juste… laissé couler. D’autres recherches l’ont confirmé. Des études ont révélé une diminution de la connectivité cérébrale pendant l’improvisation, liée à l’état psychologique de ‘flow’—où vous êtes complètement immergé dans une activité. Moins de réseaux actifs, mais plus ciblés. Moins de suranalyse, plus d’être. Voici le truc : les auditeurs peuvent sentir cet état. Lorsque vous entendez un grand improvisateur en état de flow, vous entendez quelqu’un penser en temps réel sans autocensure. Chaque note est un choix, mais les choix se produisent trop rapidement pour une délibération consciente. C’est la cognition sans contrôle. Et si vous êtes le genre de personne qui a besoin de contrôle, dont le cerveau déclenche des réponses d’anxiété lorsqu’il est confronté à des situations ambiguës, alors écouter ce processus, c’est comme regarder quelqu’un marcher sur une corde raide sans filet. Vous voulez regarder ailleurs. Vous voulez que ça s’arrête. Vous voulez résolution.
Retour au théâtre
Alors revenons à Perry et à ce film d’action. Que se passait-il vraiment lorsque Perry se plaignait que le film hollywoodien n’était pas assez réaliste ? Il connaissait un échec de la tolérance à l’ambiguïté. Il avait acheté un billet pour une chose—un grand film d’action, idiot et divertissant—mais son cerveau ne pouvait pas l’accepter selon ces termes. Son besoin de clôture cognitive exigeait que le film soit autre chose : plus réaliste, plus cohérent, plus résolution. C’est le même mécanisme. Perry ne peut pas laisser un film hollywoodien être ce qu’il est, de la même manière que certaines personnes ne peuvent pas laisser le jazz être ce qu’il est. Et cela va plus loin que le divertissement. Ce trait affecte tout. Les écoles de médecine testent désormais les candidats pour leur besoin de clôture cognitive, car les médecins ayant une faible tolérance à l’ambiguïté luttent contre la réalité quotidienne selon laquelle la médecine est fondamentalement incertaine. Vous avez rarement des informations parfaites. Les diagnostics sont probabilistes. Les résultats des traitements varient. Pendant la pandémie de COVID-19, les chercheurs ont découvert que les personnes ayant un grand besoin de clôture cognitive ressentaient un stress et une anxiété significativement plus élevés—car les pandémies sont la situation ambiguë ultime. Les règles changent sans cesse. Les experts ne sont pas d’accord. Rien ne se résout clairement.
Le monde, il s’avère, ressemble beaucoup plus au jazz qu’à la musique pop. Il ne se résout pas selon le calendrier. Les changements continuent d’arriver. Les motifs se déplacent. Et si vous ne pouvez pas tolérer cela—si vous avez besoin que tout ait un sens, atterrisse sur la tonique, revienne au familier—vous allez passer beaucoup de temps anxieux.
La qualité manquante
Alors, quelle est la qualité manquante que je cherchais ? La chose qui sépare les personnes qui deviennent nerveuses en écoutant du jazz de celles qui le trouvent libérateur ? Ce n’est pas exactement la patience pour la vie. C’est quelque chose de plus spécifique : la capacité à rester dans une tension non résolue sans avoir besoin de la résoudre. C’est la capacité d’entendre Miles Davis dire ‘Ne joue pas ce qui est là, joue ce qui n’est pas là’ et de se sentir excité plutôt que confus. C’est être capable de regarder un film d’action hollywoodien et de l’apprécier parce que ce n’est pas un documentaire, non malgré cela. C’est comprendre que certaines des plus belles choses de la vie se produisent dans les espaces entre la certitude et la résolution. Les pionniers du bebop l’avaient compris. Lorsque le bebop a émergé, les musiciens sentaient que leur musique devait être très propre, très précise, quelque chose de beau dirigé plus ou moins vers les gens, mais beau d’une manière qui exigeait un engagement actif, pas une consommation passive. Les musiciens contemporains comme Itamar Borochov le comprennent aussi. Ils n’essaient pas de rendre le jazz plus facile ou plus accessible en le simplifiant. Ils vous invitent dans l’ambiguïté, en disant : cette incertitude, cette non-résolution, c’est là que réside la magie. Mais vous devez être prêt à vivre là avec eux.
Ce que nous choisissons d’entendre Nina Simone, qui a passé des années à rechercher la perfection classique avant d’embrasser le jazz, l’a très bien dit : ‘J’avais passé de nombreuses années à rechercher l’excellence, car c’est ce qu’est la musique classique… Maintenant, c’était dédié à la liberté, et c’était bien plus important’. L’excellence contre la liberté. Le contrôle contre le flow. La résolution contre la possibilité. Ce ne sont pas seulement des choix musicaux. Ce sont des choix de vie. Perry n’aimera probablement jamais le jazz moderne. Ce n’est pas grave. Mais je me demande parfois si l’anxiété qu’il ressent lorsqu’il entend ces ‘phrases nerveuses et rapides’ essaie de lui dire quelque chose. Non pas sur la musique, mais sur la façon dont il traite le monde. Parce que voici le truc à propos de la tolérance à l’ambiguïté : ce n’est pas figé. C’est une compétence que vous pouvez développer. Chaque fois que vous vous asseyez avec l’incertitude au lieu de vous précipiter pour la résoudre, vous entraînez votre cerveau à en gérer davantage. Chaque fois que vous laissez une question ouverte, laissez une tension non résolue, laissez une possibilité planer, vous élargissez votre capacité.
Parce que voici le truc à propos de la tolérance à l’ambiguïté : ce n’est pas figé. C’est une compétence que vous pouvez développer. Chaque fois que vous vous asseyez avec l’incertitude au lieu de vous précipiter pour la résoudre, vous entraînez votre cerveau à en gérer davantage. Chaque fois que vous laissez une question ouverte, laissez une tension non résolue, laissez une possibilité planer, vous élargissez votre capacité. C’est peut-être pour cela que Miles Davis a dit ‘N’ayez pas peur des erreurs. Il n’y en a pas’. Non pas parce que les fausses notes n’existent pas, mais parce que dans l’improvisation, dans la vie, la seule véritable erreur est d’avoir tellement peur de l’incertitude que l’on ne se lance jamais. Certaines personnes n’entendent que ce qui est là. D’autres entendent ce qui n’est pas là—l’espace entre les notes, la tension entre les accords, les possibilités infinies qui planent dans ce silence avant que la phrase suivante ne commence. Et cela, plus que toute compétence technique ou connaissance théorique, est ce qui sépare ceux qui peuvent gérer le jazz de ceux qui ne le peuvent pas. Il ne s’agit pas du tout de la musique. Il s’agit de savoir si vous pouvez vivre dans un monde qui refuse de se résoudre selon votre calendrier.
Sources Scientific Research:
- McLain, D. L., et al. (2015). “Ambiguity tolerance in organisations: definitional clarification and perspectives on future research.” Frontiers in Psychology.
- Berenbaum, H., et al. (2007). “Intolerance of uncertainty: Exploring its dimensionality and associations with need for cognitive closure, psychopathology, and personality.” Journal of Anxiety Disorders.
- Nave, G., et al. (2018). “Musical preferences predict personality: Evidence from active listening and Facebook likes.” Psychological Science.
- Vella, E., & Mills, G. (2017). “Personality, uses of music, and music preference: The influence of openness to experience and extraversion.” Psychology of Music.
- Limb, C. J., & Braun, A. R. (2008). “Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: An fMRI Study of Jazz Improvisation.” PLOS ONE.
- Vergara, V. M., et al. (2021). “Functional Network Connectivity During Jazz Improvisation.” Scientific Reports.
- Norgaard, M., et al. (2019). “How jazz improvisation affects the brain.” Neuroscience News.
- Roets, A., & Van Hiel, A. (2021). “Need for cognitive closure predicts stress and anxiety of college students during COVID-19 pandemic.” Personality and Individual Differences.
- Hillen, M. A., et al. (2020). “Need for cognitive closure, tolerance for ambiguity, and perfectionism in medical school applicants.” BMC Medical Education.
Jazz History and Criticism:
- DeVeaux, S. (1997). “The Birth of Bebop: A Social and Musical History.”
- Porter, L. (1998). “John Coltrane: His Life and Music.”
- Gilbert, A. (2008). “The Israeli Jazz Wave: Promised Land to Promised Land.” JazzTimes.
- Russonello, G. (2019). Reviews and articles. The New York Times. Artist Profiles and Interviews:
- Yellowjackets’ official website and Grammy Archives
- Itamar Borochov’s official biography and press materials
- Avishai Cohen interviews, Jazz Japan
- Israel21c feature on Itamar Borochov (2021)
- The Tower magazine: “Jazz from the Promised Land”
- All About Jazz artist profiles
Music Analysis:
- Hooktheory database analysis of “Giant Steps”
- Library of Congress National Recording Registry essay on “Giant Steps”
- Piano With Jonny: “Giant Steps—A Guide to Coltrane Changes”
- Various jazz education resources on bebop history and Coltrane changes