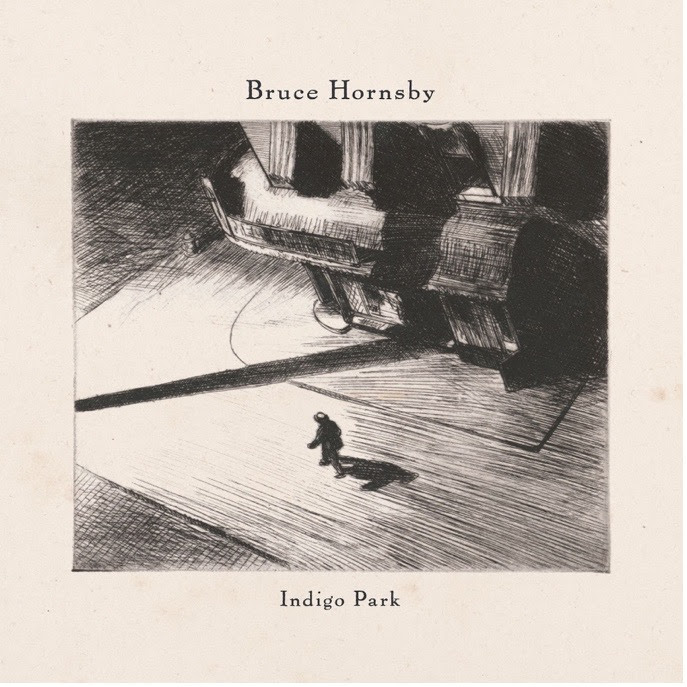Quelque part au milieu des années soixante, au cœur de Dakar, le légendaire poète-président Léopold Sédar Senghor avait une vision. Son ministère des Affaires étrangères fonda le Club Baobab, non pas une simple boîte de nuit, mais un hub diplomatique où les dignitaires devaient être reçus sur une bande-son des meilleurs musiciens que le Sénégal avait à offrir. Les meilleurs guitaristes, saxophonistes et chanteurs furent débauchés à travers tout Dakar, même du Club Miami, pour l’orchestre maison. C’était en 1970. Le baobab, ce symbole séculaire et indestructible de l’Afrique, trouvait son équivalent musical.
Cinquante-cinq ans plus tard, un jeudi soir trop chaud à Heerlen, les Pays-Bas,cet arbre est toujours debout. Mieux encore : il fleurit.
Le Parkstad Limburg Theater n’affiche pas complet – il y a de l’espace, de l’air même, ce qui s’avérera crucial plus tard dans la soirée quand plus personne ne pourra rester immobile – mais l’attente est palpable dans l’atmosphère. Ceci n’est pas un concert. C’est une audience avec des légendes vivantes. Et lorsque Orchestra Baobab, tous vêtus d’un blanc impeccable, monte sur scène, l’anticipation devient presque tangible.
L’ouverture est une déclaration de respect. « Caravana », un hommage à Ndiouga Dieng, le père fondateur décédé en 2016. Sa voix chaude et soyeuse n’est plus, mais le rythme doux et chaloupé et le saxophone fredonnant font ce que Baobab a toujours fait : ils créent un univers. Pas de grandiloquence. Pas de cris pour attirer l’attention. Juste ce groove irrésistible et pur sur lequel des générations ont grandi.
Les grands noms sont partis. Thione Seck, Medoune Diallo, Laye Mboup, Rudy Gomis, tous sont décédés. Celui qui parcourt la page Wikipedia d’Orchestra Baobab reçoit une leçon mélancolique sur l’impermanence. Mais celui qui se trouve ce soir à Heerlen voit l’inverse : l’immortalité.
Car ce n’est pas un groupe hommage qui imite les jours de gloire. C’est un organisme vivant qui se régénère de l’intérieur, exactement comme Senghor l’avait prévu : toujours les meilleurs. De jeunes musiciens ont été ajoutés, l’énergie s’est renouvelée. Et pour la première fois dans les 55 ans d’histoire du groupe, une femme se tient sur scène : Korka Dieng, la diva qui a brisé le mur de testostérone. C’est symbolique et en même temps parfaitement naturel. Baobab a toujours été plus grand que ses branches individuelles.
Le public reflète cette continuité. Des têtes grises partout, des gens qui ont grandi avec cette musique au fil des années, qui ne connaissent peut-être l’apogée de Baobab dans les années soixante-dix que par le vinyle, mais qui n’ont jamais perdu la foi. Et bien sûr, dispersée dans la salle : la diaspora sénégalaise, pour qui cette soirée est plus qu’un concert. C’est la maison. Ce sont les racines, rendues vivantes par des musiciens en blanc.
Après « Caravana », on sait à quoi s’attendre. Ce ne sera pas un concert assis tranquille. « Anna Maria » explose – un morceau dansant qui s’appuie lourdement sur un riff de saxophone si doux qu’il vous donne du sucre. Le chant polyphonique donne la chair de poule. Littéralement. Le froid limbourgeois disparaît ; ce qui reste, c’est la chaleur ouest-africaine.
Et puis : le guitariste. René Sowatche, originaire du Bénin mais établi depuis des années sur la scène musicale sénégalaise, s’empare de son rôle principal ce soir à deux mains. Un solo jazzy plein d’arpèges qui s’écoulent les uns dans les autres comme l’huile de palme entre vos doigts. Ce n’est pas de la démonstration. C’est du savoir-faire d’une autre époque, d’une autre culture, apporté dans le sud du Limbourg avec une précision chirurgicale. Sowatche est l’un de ces rares musiciens qui joue aussi facilement l’afrobeat, le highlife et le mbalax, et ce soir il opte pour des runs mélodieux et jazzy qui plongent la salle en transe.
La salle ne peut plus rester immobile. Les gens qui regardaient poliment la première demi-heure se balancent maintenant. D’autres dansent pleinement. L’espace dans la salle – initialement signe d’une vente de billets modeste – s’avère être une bénédiction. Cela a besoin d’espace. Cela a besoin de mouvement.
Et puis vient l’uppercut : un medley de classiques. « Buul Ma Mim », « On Verra Ça » – des morceaux que tout le monde connaît, ou croit connaître, jusqu’à ce qu’ils soient entendus en direct et explosent d’une manière qu’aucun enregistrement n’a jamais capturée.
Mais le véritable climax résidait, rétrospectivement, déjà dans la première moitié du spectacle. Lorsque les accords d’ouverture d’« Utrus Horas » résonnent, un soupir collectif traverse la salle. C’est le moment que tout le monde attendait. Le morceau légendaire de l’album tout aussi légendaire Pirates Choice de 1982 – le disque qui a mis Baobab sur la carte mondiale quand Youssou N’Dour, l’homme qui avait failli les détruire avec sa révolution mbalax, les a sortis de l’oubli en 2001.
« Utrus Horas » est une fusion cubano-africaine d’une hauteur solitaire. La composition démontre comment la musique latine a bouclé la boucle complète : de l’Afrique de l’Ouest à Cuba sur des bateaux négriers, retour à Dakar dans les années quarante via les marins et les radios, et finalement transformée en quelque chose de nouveau, quelque chose qui n’appartient à personne et à tout le monde.
Le saxophone pleure. La percussion roule. La guitare de Sowatche voltige à travers les accords comme un enfant qui saute sur des pavés. Et vous le sentez – la chair de poule à des endroits où vous ne l’attendez pas. Dans votre nuque. Sur vos avant-bras. Quelque part au fond de votre ventre. Ce n’est pas de la nostalgie. C’est l’intemporalité.
Mais aucun arbre ne se tient sans racines. Et les racines d’Orchestra Baobab sont les hommes qui font la même chose depuis cinquante ans : dicter le groove. Mountaga Koité, 72 ans, est assis derrière ses tambours et timbales avec un sourire qui semble lui-même rythmique. Cet homme n’a jamais rien fait d’autre que de la musique. Il respire en quatre-quatre. Il cligne des yeux en clave. Et ce soir, comme il le fait depuis cinq décennies, il pose une fondation sur laquelle le reste du groupe peut danser, chanter et planer. Pas de fioritures. Pas d’ego. Juste ce groove inébranlable et hypnotique qui définit Orchestra Baobab.
La section rythmique est stoïque au meilleur sens du terme. Ils sont le cœur battant qui ne doute jamais, n’hésite jamais. Sowatche peut bien s’occuper des solos jazzy, les saxophonistes peuvent bien acclamer et pleurer – sans Koité et ses camarades, tout cela s’effondrerait. Mais avec eux ? Avec eux, c’est un perpetuum mobile.
Et puis il y a bien sûr Korka Dieng, la première femme à faire partie de la formation de Baobab. Sa voix ajoute une nouvelle couleur à la palette – pas douce, pas docile, mais puissante et incontournable. Elle revendique sa place sur cette scène avec une évidence qui fait oublier que c’était autrefois différent.
Lorsque les dernières notes se sont éteintes, le public a continué à réclamer plus. Davantage de rappels ont été exigés. Mais Orchestra Baobab n’a pas cédé. Pas de chansons supplémentaires. Pas d’ovation prolongée sur scène. Ils avaient donné ce qu’ils étaient venus donner, et c’était plus que suffisant.
Ce n’était pas une conclusion. C’était une mise en jambes.
Car en avril 2026 sortira Made in Senegal, le nouvel album sur lequel le groupe travaille depuis des années. La tournée qui suivra sera plus grande, plus chargée, plus urgente. Heerlen était un essai routier. Et tandis que les gens sortent, dans le froid limbourgeois, on entend partout les mêmes pensées : c’était spécial. Mais ce n’était que le début.
À une époque où les groupes des années soixante-dix sont surtout devenus des machines à nostalgie – des billets à des centaines d’euros, des playbacks, des hologrammes de membres décédés – Orchestra Baobab est autre chose. Ils ne s’occupent pas du passé. Ils s’occupent du présent. D’une musique qui évolue, de jeunes musiciens qui reprennent le flambeau sans éteindre la flamme, d’un son qui était révolutionnaire en 1970 et reste vital en 2025.
Léopold Sédar Senghor avait une vision : un club où les meilleurs jouaient pour les meilleurs. Ce club n’existe plus. Mais l’arbre qui a été planté pour lui est toujours debout. Mieux encore : il porte de nouveaux fruits.
Lorsque Orchestra Baobab reviendra l’année prochaine avec Made in Senegal, Heerlen sera prêt. Car ceux qui se trouvaient jeudi soir au Parkstad Limburg Theater savent maintenant ce que le reste du monde redécouvrira bientôt : que la magie afro-cubaine n’a pas de date de péremption, que le groove transcende les générations, et qu’un baobab ne tombe pas.
Il continue simplement à grandir.
La tournée se poursuit jusqu’à la fin novembre avec des concerts en Allemagne et en Suisse, donnant au public européen encore quelques précieuses occasions de témoigner de cette légende vivante avant la sortie du nouvel album au printemps 2026.